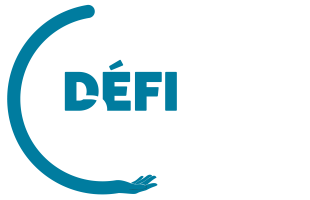L’avenir de l’engagement des États-Unis au Moyen-Orient vu par les experts américains

Tilila Sara Bakrim est étudiante et assistante de recherche en Affaires internationales à Sciences Po et à King's College (Londres). Passionnée par les enjeux stratégiques de la zone Afrique du Nord / Moyen-Orient, elle écrit régulièrement des articles traitant des relations internationales pour de nombreux médias et think-thank.
*note publiée sur le site internet de la Fondation pour la Recherche stratégique
Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, le Congrès américain lança une autorisation pour l’utilisation de la force militaire (2001 Authorization for Use of Military Force, AUMF), qui permit au président, George W. Bush, de lancer des opérations militaires « contre les nations, organisations ou personnes ayant planifié, autorisé, commis ou aidé » ces attaques. Depuis l’ère Obama, l’empreinte militaire des États-Unis dans la région s’est considérablement réduite, Washington se tournant plutôt vers l’Indo-Pacifique. Ainsi, la présence militaire américaine (qui se concentre principalement au Qatar, au Bahreïn, au Koweït, en Arabie saoudite, en Turquie, en Afghanistan et en Irak) a progressivement diminué, passant de 70 000 troupes en 1990 à environ 30 000 juste avant le retrait d’Afghanistan et 16 000 après le retrait. Le mandat de Donald Trump, marqué par une double politique de pression maximum sur l’Iran et de soutien sans limites aux alliés (Arabie saoudite, mais surtout Israël), recentre l’action américaine sur ses priorités essentielles sans pour autant afficher une position claire sur les différents conflits qui traversent la région. L’enjeu actuel de l’engagement américain est de faire en sorte de continuer à protéger les intérêts économiques, politiques et diplomatiques des Etats-Unis, sujet aux concurrences géopolitiques et aux instabilités. En effet, la chute des prix du baril de brut, les guerres civiles et d’influence (Syrie, Libye, Yémen…), la menace terroriste, les révoltes populaires et la crise sanitaire menacent ces intérêts. L’engagement des Etats-Unis au Moyen-Orient (que l’on peut plus ou moins résumer à la région du Levant et du Golfe) a beaucoup évolué depuis la fin de la Guerre froide, passant d’un interventionnisme politico-militaire à un repositionnement plus complexe et nuancé aujourd’hui. Comment alors les experts américains analysent-ils l’action des États-Unis au Moyen-Orient depuis une dizaine d’années ? De quel désengagement et de quel engagement parle-t-on ? La présente note vise à mettre en avant les débats des experts américains relatifs à la stratégie politique et militaire actuelle des États-Unis au Moyen-Orient, ainsi que leur influence réelle sur la scène régionale. Il s’agira de mettre en lumière la perspective américaine sur le sujet afin de comprendre comment le changement de stratégie politique, commerciale et militaire qui sera ici traité est perçu par les analystes, les chercheurs et les journalistes américains afin de comprendre quelle stratégie est prônée par les principaux centres de réflexion aux Etats-Unis. Cette analyse permettra de situer où en est la politique américaine dans les principaux domaines où elle à l’œuvre au Moyen-Orient : antiterrorisme (la « guerre contre la terreur »), maintien de la paix et de la stabilité (les États-Unis comme « gendarmes du monde »), enjeux commerciaux (vente d’armement, protection de l’accès aux voies maritimes stratégiques, etc.). Pour ce faire, la note commencera par décrypter l’évolution de la stratégie de Washington qui a conduit à un désengagement militaire progressif, pour ensuite souligner les intérêts vitaux qui sous-tendent toujours l’implication des États-Unis au Moyen-Orient ; elle analysera enfin le repositionnement de la politique étrangère américaine dans le cadre d’un nouveau rapport de force dans la région.
La fin de l’influence et de l’interventionnisme américains ?
Après la fin de la Guerre froide et l’opération « Tempête du Désert » menée par les États-Unis sous mandat onusien, ces derniers se sont retrouvés dans une situation inédite d’hégémonie. Ce statut a permis à Washington d’imposer un certain leadership dans la région et d’influencer les relations interétatiques au Moyen-Orient (et bien au-delà). Mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis se concentrent moins sur la supervision de la géopolitique régionale que sur des intérêts de sécurité intérieure et extérieure. L’objectif est clair : mener la « guerre contre la Terreur » en désignant un « axe du mal » comprenant l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord. Face à l’Iran, dont le régime qualifie les États-Unis de « Grand Satan » et Israël de « Petit Satan », l’un des enjeux est de contrer son influence dans la région, notamment le croissant chiite allant de l’Irak au Liban et menaçant la sécurité d’Israël. Vis-à-vis de Bagdad, l’objectif en 2003 était de se débarrasser du régime de Saddam Hussein (accusé – sans preuves réelles – de détenir des armes de destruction massive et de soutenir le terrorisme) et d’y apporter un régime plus démocratique. Vingt ans plus tard, le bilan est plus que mitigé.
Les interventions des États-Unis n’ont pas atteint leurs objectifs en termes de stabilité, de sécurité et de développement.
Dès 2008, les diplomates Richard N. Haass (ayant exercé sous le mandat de George W. Bush entre 2001 et 2003) et Martin S. Indyk (ayant exercé durant la présidence Clinton, entre 1997 et 2001) affirmaient la nécessité d’un changement de stratégie en Irak suite au fiasco de l’invasion de 2003, devenu l’un des sujets les plus polarisants de la politique américaine contemporaine. En effet, au sein même des partis démocrate et républicain, les élus sont en désaccord fondamental quant aux raisons qui ont poussé à la guerre en Irak, à l’impact réel de la présence américaine et aux modalités de retrait des troupes d’Irak. Aussi, d’après Haass et Indyk, il est nécessaire que les États-Unis se désengagent militairement de l’Irak et mettent fin à leur présence tout en conservant un lien avec les décideurs irakiens afin de continuer à assurer les intérêts américains. Ils suggèrent, pour éviter une nouvelle guerre civile sur fond de tensions ethno-religieuses et pour maintenir une certaine stabilité dans le pays, de mettre en place un système de cessez-le-feu similaire à celui appliqué en Bosnie et au Kosovo. Ainsi, le désengagement militaire serait progressif car au sein même de la population irakienne, il y a une demande d’un certain soutien des États-Unis pour assurer la sécurité et la stabilité du pays, et des craintes quant aux conséquences possibles pour le pays et la région d’un retrait trop brusque des troupes américaines. En ce qui concerne la Syrie, la stratégie américaine menée depuis les années 1970 s’est soldée par un échec. Tout d’abord, le refus de Damas de reconnaître Israël a contribué à refroidir les relations américano-syriennes. Ensuite, parce que le régime a fusionné les intérêts de l’État syrien avec les intérêts privés de la famille Assad, sa survie s’est rapidement définie par une opposition aux intérêts régionaux des Etats-Unis et d’Israël. C’est pour cela que la légitimité et la position régionales du régime d’Assad dépendent de son rejet d’Israël et que, par conséquent, la Syrie s’est engagée dans des alliances contraires aux intérêts américains – soutien de groupes armés contre Israël et alliance avec l’Iran (depuis 1979). D’où sa qualification de « backlash state » par l’ancien Secrétaire national à la sécurité de Bill Clinton, Anthony Lake. La Syrie et l’Iran cherchent en effet, depuis des décennies, à contrecarrer les intérêts américains en sponsorisant les principaux groupes armés résistant à la paix arabo-israélienne (Hezbollah, Hamas, etc.). Selon Tamara Cofman Wittes, chercheuse à la Brookings Institution, le véritable enjeu pour la politique américaine au Moyen-Orient est de mettre fin à cette longue période de « purgatoire » (qui a commencé avec les interventions en Irak et en Afghanistan) en se désengageant progressivement, malgré le coût et les risques. Car, comme l'ont montré ces interventions, même un investissement plus élevé des États-Unis n’aidera pas à la stabilité, à la démocratisation et au développement de la région. C’est la fin de la politique du nation building. Les discours d’Obama au sujet de la politique moyen-orientale américaine (2009-2016), dont les objectifs n’ont pas été réalisés, illustrent cet échec. Le discours du Caire (2009), censé donner le ton de cette politique, a rappelé le soutien à long terme des États-Unis à la démocratie comme le régime le plus adapté pour servir la volonté populaire et la stabilité. De ce point de vue, l’administration Obama a fait en sorte de rompre avec le néoconservatisme de Bush. En effet, la mise en valeur de la démocratie par une administration alors tout juste entrée en fonction visait tout d’abord à se démarquer de son prédécesseur avant d’élaborer une véritable stratégie pour la région. Cependant, différents observateurs ont interprété la position d’Obama comme une volonté de maintien du statu quo et non de changement. C’est le cas du chercheur américano-libanais Fawaz Gerges, qui a pu affirmer que « [le nouveau président a mis entre parenthèses la promotion de la démocratie et a soutenu à la place les alliés traditionnels des Américains au Moyen-Orient – l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie, le Pakistan et Israël – sans prendre en compte leur politique interne et leur comportement vis-à-vis de leurs citoyens] » . En réalité, cette mise en avant de la démocratie dans les discours d’Obama a été vue par l’opinion publique des différents pays de la région comme portant la marque d’un néo-impérialisme qui a conduit aux insurrections civiles, à la violence et à l’instabilité (cf. Irak, Afghanistan). Les limites de l’influence américaine au Moyen-Orient peuvent s’observer jusque dans les relations américano-israéliennes. Israël n’a pas gelé ses activités de colonisation dans les territoires palestiniens occupés, malgré la baisse de leur popularité au sein de l’opinion publique américaine (en 2017, 62 % des Américains éprouvaient plus de sympathie envers Israël qu’envers les Palestiniens dans le conflit israélo-palestinien ; le chiffre est tombé 58 % en 2021 ). Un événement particulier brouilla les relations américano-israéliennes – lorsque l’administration d’Obama s’est abstenue lors du vote de la résolution 2334 du 23 décembre 2016 condamnant les colonies israéliennes au Conseil de sécurité de l’ONU . Cette action n’a permis ni de reprendre le processus de paix et de solution à deux États, ni d’affirmer l’influence des États-Unis sur son allié israélien. Elle a cependant montré aux États-Unis les limites de leur influence et de leur soft power au Moyen-Orient et, surtout, les nombreuses barrières qui compliquent depuis longtemps leurs initiatives diplomatiques (comme le manque d’allant du Pakistan pour mettre en place une politique plus agressive envers les Taliban). Ce déclin de l’influence des États-Unis au Moyen-Orient a conduit à l’adoption d’une position plus réaliste dans la région, Washington se contentant de maintenir les institutions déjà en place sans émettre de jugement, plutôt que de promouvoir la démocratie libérale et le nation-building. En effet, la doctrine américaine de la « destinée manifeste », donnant pour mission divine à la nation américaine l’expansion de la civilisation, de la liberté et de la démocratie dans le monde se heurte aux particularités des États et à leur incompatibilité avec la vision et le système américains. Or, depuis le début du XXIe siècle, on observe l’inefficacité de cette politique. Un rapport conjoint de l’institut Brookings et de la Banque mondiale en date de juin 2020 résume les différents obstacles que les États-Unis ont rencontrés dans les projets d’aide humanitaire, de stabilisation et de développement économique. Tout d’abord, les efforts de stabilisation, de reconstruction et de développement depuis la Seconde guerre mondiale n’ont pas su évaluer les dynamiques de pouvoir politique, économique et social à chaque étape de la planification, jusqu’à parfois contribuer à générer un conflit civil, comme ce fut le cas en Irak. L’intégration de ce constat dans les efforts de consolidation de la paix et de développement exige donc une analyse approfondie de la dynamique du pouvoir politique, économique et social, non seulement au niveau de la zone de conflit, mais aussi aux niveaux régional et international. Le soutien et la coordination internationaux qu’ont apporté les États-Unis après les printemps arabes pour résoudre les conflits, restaurer une certaine stabilité régionale et aider les réfugiés sont insuffisants par rapport aux besoins. L’architecture mondiale forgée après la Seconde guerre mondiale pour aider les États dans de telles circonstances n’a pu ni prévenir, ni atténuer, ni résoudre les conflits. Un autre facteur réside dans le fait que l’ordre international se construit désormais dans une compétition entre Washington et Pékin. Plus que d’une compétition d’ordre économique, il s’agit véritablement de deux visions de l’ordre mondial qui s’affrontent. Alors que l’aide au développement et humanitaire américaine est surtout vue comme suspecte dans l’opinion publique des pays arabes (seulement 18 % des citoyens d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient pensent que l’aide américaine est motivée par un désir de développement économique), la Chine conserve sa réputation de pays qui ne s’ingère pas dans les affaires intérieures des pays, ce qui confère un avantage au modèle de développement chinois pour les économies émergentes. En effet, l’insistance des États-Unis à prôner un modèle de développement libéral, qui transparaît à travers les politiques menées par certaines organisations internationales (FMI, Banque mondiale), ajoute une contrainte supplémentaire dans l’aide au développement des pays bénéficiaires qui doivent rendre des comptes en matière de transparence et de démocratie.
Le Moyen-Orient n’est plus la priorité dans la stratégie globale des États-Unis.
Le directeur du Al-Ahram Center of Political and Strategic Studies au Caire, Abdel Moneim Saeed, affirme que la politique internationale des États-Unis vise toujours au leadership mondial mais en se repositionnant en Europe et dans le Pacifique (et moins au Moyen-Orient) afin de renforcer les alliances avec les autres membres de l’OTAN, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud. Pour certains médias américains libéraux, comme The Atlantic, les États-Unis devraient tout simplement se débarrasser du dogme interventionniste qui a influencé leur politique étrangère jusqu’ici et n’a conduit qu’à des désastres dans la région (dont la « guerre contre la terreur » entamée par George W. Bush). Pour le directeur de la CIA (ancien président du think tank américain Carnegie Endowment for International Peace) William J. Burns, les États-Unis doivent donc recalibrer leurs relations dans la région afin de maintenir un certain statu quo Avec l’Arabie saoudite et les autres pays du Golfe, cela signifie un soutien pour leur sécurité contre les menaces extérieures, qu’elles proviennent de l’Iran ou de tout autre pays, et un appui significatif à la modernisation politique et économique. Cependant, les pays du Golfe devraient cesser d’agir comme s’ils avaient droit à un chèque en blanc de la part des États-Unis pour mettre fin à la guerre au Yémen, et arrêter leur ingérence dans les transitions politiques dans des pays comme la Libye et le Soudan et gérer leurs rivalités internes. Concernant l’Iran, les États-Unis ont tout intérêt à revenir à un accord nucléaire actualisé. Ce ne sera pas un remède miracle à toutes les divergences entre Washington et le régime actuel de Téhéran, mais il s’agira d’un point de départ essentiel pour contrer les menaces nucléaires iraniennes et, à terme, les réduire. Le Moyen-Orient est donc moins une préoccupation majeure pour les États-Unis qu’il y a trente ans, quand ils exerçaient une quasi-hégémonie et dépendaient de la région pour leur approvisionnement en hydrocarbures. Selon les chercheurs Aaron David Miller et Richard Sokolsky du Carnegie Endowment for International Peace, la fin de la Guerre froide, le développement de sources d’énergie non fossile et la découverte de larges réserves de pétrole et de gaz hors du Golfe ont diminué l’intérêt qu’avaient les Américains pour le Moyen-Orient. 85 % des exportations de pétrole provenant du Golfe vont désormais à la Chine, à l’Inde, au Japon et à la Corée du Sud. Concernant l’engagement militaire, contrairement à d’autres analystes, Miller et Sokolsky pensent qu’il est illusoire de croire qu’une politique étrangère moins militarisée – une politique qui s'appuie davantage sur la diplomatie, l'aide au développement et les programmes de renforcement de la démocratie plutôt que sur l'utilisation de la force militaire – aurait permis d'obtenir de meilleurs résultats au niveau de la stabilité, du développement économique et de la transition démocratique. Les rivalités sectaires, ethniques, régionales et tribales, l’insuffisance en termes de leadership, d’état de droit et de libertés fondamentales, la mauvaise gouvernance et la faiblesse des institutions, le manque de transparence, de respect des droits humains et de prise en compte de l’égalité des sexes, ainsi que la corruption généralisée ont créé une région brisée et dysfonctionnelle que les États-Unis ne sont pas en mesure d’améliorer, et encore moins de « réparer ». Selon Miller et Sokolsky, ces défis devraient être pris en charge et résolus principalement par les puissances régionales. Les intérêts américains qui subsistent dans la région doivent être abordés d’une manière plus unilatérale et ciblée afin de garantir la sécurité nationale et internationale des États-Unis.
Des enjeux économiques, sécuritaires et géopolitiques à surveiller dans un contexte d’instabilité.
Assurer l’accès aux voies maritimes stratégiques et bénéficier des réseaux économiques et financiers.
Un des intérêts économiques prioritaires des États-Unis dans la région est de maintenir une relative stabilité pour assurer l’accès aux voies maritimes stratégiques (mer Rouge et golfe arabo-persique notamment) et ne pas ébranler le commerce mondial. Cela peut expliquer, entre autres, pourquoi les Américains ont une forte présence au Qatar, au Koweït et à Bahreïn, pays stratégiques de l’économie mondiale et du commerce des hydrocarbures. La plus importante base militaire américaine est celle d’Al-Udeid, qui hébergerait environ 10 000 soldats américains en plus du siège du CENTCOM (le commandement responsable des opérations militaires des Etats-Unis au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud). Ainsi, même si les États-Unis sont devenus exportateurs de pétrole, il n’en reste pas moins que le contrôle des ressources pétrolières subsiste dans la compétition entre grandes puissances (le pétrole du Golfe s’exporte à l’Est et non plus seulement à l’Ouest). Les Etats-Unis restent en grande partie bénéficiaires des réseaux économiques et financiers dans les régions où ils sont implantés, et cela reste un facteur non négligeable de leur engagement. Selon l’universitaire et ancien diplomate Ghassan Salamé, les États-Unis ont « privatisé » une grande partie de leurs opérations extérieures. Lors de l’invasion d’Irak en 2003, un véritable réseau économique et financier s’est formé, dont les États-Unis étaient le principal bénéficiaire. De jeunes soldats étaient envoyés au front ainsi que des sociétés privées de sécurité chargées dans un premier temps de protéger les hôpitaux militaires, puis de recruter ces jeunes soldats. En effet, l’ingérence des sociétés privées sur le champ de bataille concerne d’abord le soutien à l’institution militaire : approvisionnement en nourriture et en habillement des combattants, maintenance et réparation des matériels, logistique, transports, etc. Cette forme de sous-traitance, connue sous le nom d’outsourcing dans le monde anglo-saxon et « d’externalisation » dans l’armée française, est particulièrement développée dans les régions menacées de terrorisme ou de guerre civile. Les premiers utilisateurs de ce type de firmes privées sont les États-Unis. Le déficit d’effectifs militaires depuis la fin de la Guerre froide (passés de 2,1 millions en 1991 à 1,4 million aujourd’hui) a contraint les autorités américaines à solliciter des entités civiles. À titre d’exemple, le contingent américain pendant la première guerre du Golfe (1990-1991) comptait un civil sous contrat pour cinquante militaires. En Irak, en 2004, cette proportion était passée à un pour dix, soit près de 20 000 personnes dépendant du secteur privé. L’intervention en Afghanistan (2001-2021), malgré son coût (estimé par le Pentagone à 654 milliards d’euros), a tout de même bénéficié aux États-Unis. En effet, dans les budgets dépensés toutes ces années, on omet de préciser que 40 % environ de cet argent sont revenus aux États-Unis. Pour reprendre les termes de Ghassan Salamé, « l’American way of war est d’abord un système qui crée des bénéficiaires américains ».
De nouveaux enjeux géopolitiques et sécuritaires.
Du temps de la Guerre froide, les priorités géopolitiques des États-Unis étaient la lutte contre l’influence soviétique et la défense d’Israël. Aujourd’hui, le paysage géopolitique a bien changé. Tout d’abord, bien que les Etats-Unis restent un allié majeur d’Israël, ce dernier est devenu plutôt autonome pour assurer sa sécurité extérieure. Bien que l’URSS ait disparu, la Russie est redevenue présente au Moyen-Orient, notamment en Syrie, où ses intérêts convergent avec ceux de l’Iran pour soutenir le régime de Bashar El Assad. Selon le politologue Matthieu Rey, « Vladimir Poutine trouve dans l’équation moyen-orientale une occasion de venger les camouflets infligés au temps de la grande hégémonie américaine ». À titre d’exemple, les initiatives onusiennes sont systématiquement bloquées par le veto russe et la Syrie est utilisée par la Russie comme un terrain de démonstration de ses nouveaux armements (notamment à Alep) et de ses compagnies de sécurité privées. Ainsi, depuis la présidence d’Obama, on assiste à l’émergence de plusieurs puissances régionales qui remplacent l’hégémonie qu’ont pu exercer les Etats-Unis dans la région. Des pays comme la Turquie et l’Iran constituent un nouvel enjeu géopolitique pour les Américains : d’une part, l’influence régionale de l’Iran (à travers ses milices et ses relais politiques) représente un défi majeur pour la sécurité d’Israël ; d’autre part, la Turquie, pourtant membre de l’OTAN, achète des systèmes anti-aériens S-400 à la Russie et brouille l’alliance transatlantique. Enfin, la présence de plus en plus prononcée de la Chine, via des partenariats économiques et des projets de développement dans la région, peut s’avérer préoccupante pour Washington, les pays du Golfe étant les principaux partenaires commerciaux de la Chine, selon la chercheuse associée à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Stella Hong Zhang. Protéger les intérêts géopolitiques et sécuritaires implique donc une opposition plus frontale aux États les plus hostiles, en particulier dans le Golfe. En effet, la décision de l’administration Trump – qui n’a pas été revue par l’actuelle administration Biden jusqu’ici – de retirer les États-Unis de l’accord nucléaire iranien (JCPOA – Joint Comprehensive Plan of Action) et de rechercher une approche plus affirmée pour faire face au comportement déstabilisateur de l’Iran pourrait déclencher des escalades auxquelles les États-Unis devront être prêts à faire face, en étroite coordination avec leurs alliés et partenaires. Pour des analystes américains, comme Melissa G. Dalton (chercheuse au CSIS) et Mara E. Karlin (professeure associée à l’Université Johns Hopkins), l’instabilité grandissante de la région et la révision des formes de l’engagement américain amèneraient le Congrès américain à charger le Pentagone de réfléchir à remodeler son dispositif, en rendant des comptes par le biais d’évaluations accessibles au public. Les décideurs politiques américains devraient, selon ces chercheurs, s’efforcer de façonner le dispositif de manière à ce qu’il soit flexible et réactif pour répondre aux exigences du CENTCOM (le renforcement militaire permanent contre l’Iran, considéré comme une menace « imminente » étant la principale préconisation), mais aussi dans le contexte des nouvelles priorités globales des États-Unis. D’après l’analyse de Dalton et Karlin, l’armée américaine ne quittera pas totalement le Moyen-Orient, mais il est important que la stratégie de défense nationale américaine se focalise plutôt sur l’Iran, la Russie et la Chine, et donc que sa présence soit certes plus restreinte mais plus stratégique.Par présence stratégique, Dalton et Karlin entendent un encerclement de l’Iran et de la Chine par les bases aériennes américaines (celle d’Al-Udeid au Qatar notamment) en guise de démonstration de force : en cas de conflit armé, les États-Unis et leurs alliés surpassent leurs adversaires en nombre. Selon Matthieu Rey, il n’y a jamais eu de « retrait » de la présence américaine dans la région (et en Irak tout particulièrement) mais plutôt un redéploiement des forces en présence sur le terrain. À titre d’exemple, les 6e et 7e flottes américaines ne se sont jamais retirées de la région. Depuis une dizaine d’années, les États-Unis se positionnent désormais comme des arbitres d’un nouvel espace sur lequel ils ne veulent plus intervenir que par drones et voie aérienne, ce qui a été observé notamment lors des conflits libyen et syrien. Par ailleurs, un enjeu sécuritaire majeur pour les États-Unis reste la lutte anti-terroriste dans la région, qui consiste à poursuivre et intensifier une politique de ciblage contre les groupes armés. L’exécution de Ben Laden et le recours massif aux drones (pour une lutte anti-terroriste ciblée) illustrent cette stratégie. Comme l’a affirmé un officiel du Pentagone, James H. Anderson, au Congrès américain en mai 2020 : « [les objectifs stratégiques des États-Unis sont] de s’assurer que la région n’est pas un paradis béni pour les terroristes, qu’elle n’est dominée par aucune puissance hostile aux États-Unis, et qu’elle contribue à un marché énergétique global stable ». Après le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, le président Biden a envisagé de continuer les opérations anti-terroristes si des menaces étaient identifiées dans le pays, telles que la branche locale de Daesh, qui a brutalement frappé l’aéroport de Kaboul pendant l’évacuation des troupes américaines fin août 2021. Cependant, d’après un rapport de l’International Crisis Group en date du 17 septembre 2021, il est difficile de savoir si l’administration Biden poursuivra la politique de lutte contre le terrorisme léguée par les administrations précédentes ou si elle rompra avec le passé. En tout cas, si réévaluation il y a, elle se fera maintenant. Les groupes djihadistes ont connu une évolution spectaculaire au cours des vingt dernières années, leurs rangs se sont étoffés au cours de cette période et ils ne sont plus aussi disséminés qu’avant. Dans le même temps, les États-Unis ont développé des capacités défensives plus fortes au vu de l’instabilité internationale selon l’Interim National Security Strategic Guidance présenté par l’administration Biden en mars 2021. Cependant, la politique anti-terroriste de Biden paraît pour l’instant peu claire, voire incohérente Ainsi, vingt ans après les attentats du 11 septembre 2001 et dix ans après que les commandos américains ont tué Oussama Ben Laden, le pouvoir exécutif et le Congrès doivent encore se demander si et dans quelles circonstances la force militaire reste un outil nécessaire de lutte contre le terrorisme. Une telle réflexion est attendue depuis la présidence Obama. Selon plusieurs analystes, les dirigeants politiques doivent revoir le cadre statutaire qui a sous-tendu la guerre contre le terrorisme.
Un repositionnement de la politique étrangère américaine dans le cadre d’un nouveau rapport de force dans la région.
Vers une nouvelle stratégie diplomatique reposant sur des partenaires clés : Israël, Arabie saoudite, Égypte.
Alors que la politique des États-Unis au Moyen-Orient était largement orientée vers l’Irak et le conflit israélo-palestinien jusqu’en 2008, le président Obama fit en sorte de retirer progressivement les troupes américaines d’Irak en évoluant vers une supervision conjointe américano-irakienne des opérations sur le terrain. Pour anticiper les effets de l’influence grandissante de l’Iran, il initia également le JCPOA pour éviter le développement d’une autre capacité nucléaire dans la région qui menacerait la sécurité d’Israël. Enfin, sous le mandat de Trump, les États-Unis ont initié des accords de normalisation entre Israël et ses voisins arabes – connus aujourd’hui sous le nom d’« accords d’Abraham », comprenant les Émirats arabes unis (EAU), Bahreïn, le Soudan et le Maroc – dans le but de créer un alignement stratégique permettant de diminuer le poids de l’Iran dans la région ainsi que ses proxies et relais (Hezbollah, milices chiites irakiennes, régime syrien, houthis). En somme, les initiatives diplomatiques ont été préférées aux actions militaires préventives qui ont montré leur inefficacité, leurs risques sécuritaires et leur coût. Selon Tamara Cofman Wittes, les meilleurs résultats stratégiques des États-Unis au Moyen-Orient ont été obtenus grâce à la diplomatie, que ce soit lors des accords de Camp David (1978) ayant permis la reconnaissance de l’État d’Israël par l’Égypte et son repositionnement dans le camp occidental pendant la Guerre froide, ou la formation d’une coalition de 38 nations pour expulser Saddam Hussein hors du Koweït en 1991. Une stratégie diplomatique est donc sérieusement envisagée par plusieurs analystes américains. Selon Dalton et Karlin, les États-Unis doivent mettre davantage l’accent sur des outils non militaires pour aider les partenaires régionaux à relever les défis à long terme de la gouvernance, de la mise en place de contrats sociaux, de la consolidation de la lutte contre le terrorisme et de la stabilisation. De telles initiatives nécessiteront un financement soutenu et responsable de la part du Département d’État et de l’USAID (dont les demandes de budgets ont cependant été revues à la baisse par le Congrès américain depuis 2017, passant de 50,1 milliards $ en 2017 à 41 milliards en 2021). En somme, les outils diplomatiques, économiques (aide au développement) et de renseignement permettront, pour les Etats-Unis, une stratégie plus compétitive dans la région. Pour Martin Indyk, Mara Karlin et Tamara Cofman Wittes, la diminution de la présence américaine au Moyen-Orient nécessitera de trouver un équilibre délicat : réduire une empreinte militaire américaine obsolète sans créer davantage d’insécurité, tout en maintenant une dissuasion vis-à-vis des pays hostiles là où cela est nécessaire pour répondre aux intérêts clés des États-Unis. Selon ces mêmes auteurs, Washington a deux questions difficiles à se poser à propos de ses priorités et ses attentes : comment reprendre les négociations nucléaires avec l’Iran et comment son ambition diplomatique pourrait s’accorder avec un désengagement militaire. En ce qui concerne l’Iran, les trois analystes suggèrent que la diplomatie américaine devrait adopter une approche qui rétablirait l’accord de 2015. Dans une telle approche, les États-Unis travailleraient avec les autres parties prenantes (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et Allemagne) et l’Iran pour négocier un accord de suivi. En parallèle, ces acteurs accompagneraient la stabilité régionale. Pour ce qui est de la stratégie diplomatique régionale, les États-Unis ne devraient pas conditionner leurs redéploiements militaires aux résultats des négociations régionales (en fonction de si celles-ci vont dans leur sens ou non). Il serait par exemple plus efficace d’insister en privé pour obtenir des efforts diplomatiques sérieux de l’Arabie saoudite pour mettre fin à la guerre au Yémen et assurer la désescalade des tensions avec l’Iran.
Vers une stratégie militaire moins coûteuse.
Pour une stratégie militaire moins coûteuse, les analystes Dalton et Karlin recommandent à l’administration de progressivement repenser leurs dispositifs au Moyen-Orient – c’est-à-dire leurs bases militaires, leurs actifs et leur personnel militaire. Cela peut impliquer de réduire les effectifs et de mettre l’accent sur des investissements plus ciblés. L’objectif devrait être de laisser suffisamment de moyens pour les opérations en cours, tout en assumant un certain risque dans les scénarios moins probables, comme le prescrit la stratégie de défense nationale, qui appelle à la « prise de risques calculés ». Par exemple, le CENTCOM pourrait assouplir ses exigences concernant la présence permanente d’un groupe d’attaque de porte-avions. Les forces terrestres et les moyens de frappe pourraient également être quelque peu réduits. Enfin, il est nécessaire de diminuer les effectifs dans les quartiers généraux et les commandements unifiés américains dans la région du Golfe. Ce dernier point renforcerait également le rôle des acteurs civils (diplomates, hommes d’affaires, etc.). Cela implique de se concentrer, concernant le volet militaire, sur l’essentiel, c’est-à-dire les défenses antimissiles, des configurations navales adaptables qui garantissent un accès au littoral, des opérations spéciales et des capacités de lutte contre le terrorisme et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et, enfin, la logistique et les outils nécessaires à l’exécution de ces fonctions. Selon Melissa Dalton et Mara Karlin, les États-Unis devraient rationaliser leurs bases militaires dans la région. Des recherches menées par la RAND Corporation ont remis en question une hypothèse fondamentale sur le rôle des bases dans la sécurisation de l’accès aux voies stratégiques : une étude de 2014 a ainsi révélé que « la présence de grandes bases permanentes n’augmente pas la probabilité de sécuriser l’accès aux voies stratégiques ». L’ensemble des bases américaines (principalement situées dans le Golfe) qui ont été maintenues et développées depuis la guerre du Golfe de 1991 ont été essentielles pour mener les guerres successives en Irak et le restent pour les opérations en Afghanistan ainsi que les efforts de lutte contre le terrorisme et de dissuasion vis-à-vis de l’Iran. Seulement, si ces trois dernières missions restent des éléments clés de l’approche régionale des États-Unis dans toute une série de scénarios possibles, la conduite de ces opérations et la préparation aux éventuelles crises qui pourraient émaner de conflits futurs ne nécessitent pas le maintien de toutes les bases actuelles « chaudes » dans la région comme le définissent Dalton et Karlin. Au lieu de cela, les États-Unis pourraient faire passer certaines de leurs bases de « chaudes » à « tièdes », exploitées et entretenues par le pays hôte dans le cadre d’un accord permettant aux forces américaines de s’y déployer en cas de besoin. Pour sauvegarder leur nouvelle position sécuritaire dans la région, ils devraient augmenter les stocks d’équipements pré-positionnés dans la région, renforcer les partenariats de sécurité par le biais de conseils adaptés et ciblés, ainsi que les institutions, la formation, les exercices et les échanges pour permettre d’atteindre des objectifs de sécurité communs avec les pays partenaires. Les exercices de l’armée américaine avec un certain nombre d’armées régionales, par exemple, sont utiles à la fois d’un point de vue stratégique – pour dissuader l’Iran, rassurer les partenaires du Golfe et faciliter la coopération entre eux compte tenu des relations politiques tendues entre les différents pays du Golfe – et d’un point de vue opérationnel pour s’assurer que l’armée américaine reste prête à faire face aux futurs conflits au Moyen-Orient, en particulier si elle se concentre de plus en plus sur d’autres régions. Travailler avec des alliés tels que le Royaume-Uni et la France pour mettre en commun les ressources, les bases et synchroniser les déploiements de porte-avions au fur et à mesure que les capacités alliées et les bases régionales deviennent opérationnelles contribuerait également à compenser les changements de posture des États-Unis. Partager les ressources entre les unités de combat permet également de réaliser des économies : le CENTCOM partage déjà les ressources ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) avec l’AFRICOM. Le partage futur avec l’EUCOM, l’AFRICOM et l’INDOPACOM pourrait aussi inclure les capacités maritimes et de frappe. Cette nouvelle stratégie militaire préconisée par plusieurs analystes et chercheurs semble impliquer une modification des formes d’engagement militaire des États-Unis au Moyen-Orient de telle sorte que certaines puissances régionales participent plus activement à la coopération sécuritaire pour appuyer de fait les intérêts américains dans la région, certes moins prononcés qu’auparavant mais toujours d’actualité. Cependant, Dalton et Karlin n’évoquent pas les éventuelles contreparties à proposer aux pays partenaires ou leurs réactions, ni de dialogue préalable avec les partenaires concernés, ce qui rend cette proposition très américano-centrée.
Après trois décennies d’hégémonie américaine au Moyen-Orient, les experts américains observent un repli stratégique des États-Unis dans la région au profit d’un investissement plus important en Indopacifique, et une concentration sur les intérêts résiduels prioritaires : assurer l’accès aux voies maritimes stratégiques, bénéficier des réseaux économiques et financiers, lutter contre le terrorisme et contrer l’influence géopolitique de l’Iran. Plusieurs analystes américains recommandent une nouvelle stratégie diplomatique, visant à renforcer les partenariats avec les alliés clés des États-Unis dans la région (Israël, Arabie saoudite, Égypte essentiellement) face aux concurrents géopolitiques que sont la Russie et la Chine, tout en déployant une stratégie militaire moins coûteuse. Cela nécessite de revoir la stratégie moyen-orientale des États-Unis qui, actuellement, reste floue sous la présidence Biden. Les observateurs ne peuvent pas encore affirmer si le président continuera la politique de désengagement d’Obama. Pour l’instant, il se positionne en gardien du statu quo et ne semble pas rompre fondamentalement avec la politique menée par Donald Trump, dont aucune des mesures n’a été remise en cause. Ce qui est sûr, c’est qu’on assiste à la fin du dogme interventionniste qui avait été populaire sous Bush. En effet, l’actuel président ne semble pas intéressé par le nation-building ou le renversement des gouvernements autoritaires. On peut donc parler d’un certain retrait du leadership américain sur la scène régionale. Mais si les États-Unis laissent désormais d’autres puissances régionales agir contre les diverses menaces sécuritaires, ces dernières ne le peuvent toujours que sous son contrôle. Ainsi, la puissance définit encore en dernier lieu les États-Unis dans la région par leur force de frappe et leurs capacités militaires L’administration Biden semble poursuivre cette dynamique de désengagement régional et de maintien de la présence américaine dans des secteurs stratégiques. Dans l’Interim National Security Strategic Guidance (mars 2021), le président américain semble en revenir à une démarche plus traditionnelle, privilégiant la stabilité régionale, les valeurs fondamentales tels que les droits de l’homme et le maintien du statu quo, débutée sous Obama (dont Joe Biden était le vice-président et avait conçu avec Hillary Clinton un désengagement relatif des États-Unis du Moyen-Orient au profit du rebalance vers l’Asie). La priorité de la nouvelle administration a jusqu’ici été surtout de gérer la crise de la Covid-19 ainsi que le plan de relance, recentrant les actions de l’État sur les enjeux nationaux. Il s’agira maintenant d’observer quelles permanences et quelles ruptures l’administration Biden impulsera au Moyen-Orient ces prochaines années.